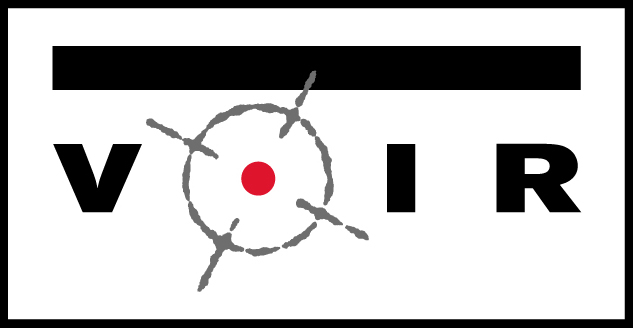
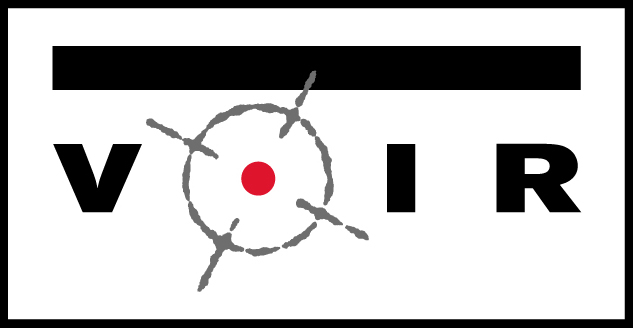
28 mai 2012 · Jérôme Lussier
Les carrés rouges ont raison de trouver brutale une hausse des droits de scolarité universitaires de 75% sur 5 ans (ou de 82% en 7 ans). Même si, à terme, ils ne paieront en moyenne que 17% du coût de leurs études. Et même si, après la hausse, ils paieront toujours moins que la moyenne canadienne. Ils ont raison, en principe, de trouver injuste que le rattrapage pour des décennies d’inaction se fasse d’un coup, sur le dos d’une génération qui n’est pas responsable de l’état du Québec contemporain et qui paiera sans doute longtemps pour quelques étourderies des babyboomers.
Mais ce n’est pas parce que des gouvernements successifs ont manqué de courage et de réalisme qu’il faut se contenter d’un statu quo insoutenable. Il aurait fallu indexer les frais de scolarité il y a 40 ans. Ça n’a pas été fait, pour toutes sortes de mauvaises raisons, incluant l’idée que des notions élaborées dans les années 60 constituent un évangile auquel le Québec doit se soumettre pour l’éternité. Le monde évolue et les contextes changent. Tôt ou tard, il fallait dégeler les frais de scolarité. Le PQ et les Libéraux n’ont rien fait pendant des décennies, aggravant le sous-financement universitaire et rendant le rattrapage encore plus urgent. Le gouvernement Charest est passé à l’action dans son budget de l’an dernier. On peut débattre des modalités, mais il semble que le principe du dégel devrait être accepté.
Les étudiants en grève ont raison d’être révoltés à l’idée de payer plus alors même que le gouvernement québécois semble gangrené par la corruption et qu’on découvre tous les mois de nouveaux scandales de copinage et de gaspillage des fonds publics. Comment peut-on justifier l’augmentation de la contribution étudiante quand on sait que les deniers publics sont apparemment siphonnés par des réseaux d’influence et la collusion systémique? C’est une excellente question.
Le problème, c’est que cette question pourra être posée par tout groupe éventuellement appelé à contribuer davantage au financement des services publics. Les propriétaires de Hummer, les administrations obèses et les spoliateurs de ressources naturelles pourront tous, eux aussi, invoquer la corruption et le gaspillage apparents pour refuser de hausser leur contribution. À partir du moment où le standard de légitimité d’un gouvernement consiste en une gestion parfaite (donc utopique) des fonds publics, il devient impossible de réformer quoi que ce soit. La solution à la corruption, au copinage et à la collusion, c’est la lutte constante et impitoyable à la corruption, au copinage et à la collusion. Mais on ne peut pas décréter un moratoire sur des changements nécessaires sous prétexte que du gaspillage existe encore. Les actions doivent se faire en parallèle.
Les carrés rouges ont raison de relier la hausse des droits de scolarité à un programme politique et économique plus large. Amorcé par les Lucides en 2005, détaillé par le rapport Montmarquette de 2008, relancé par les trois rapports des économistes chargés de conseiller le ministre Bachand en 2009 et 2010, le plan consiste à rééquilibrer les finances du Québec en favorisant la croissance économique, en rationalisant la gestion de l’État et en tarifant davantage certains services. Cette dernière mesure, en particulier, a comme effet d’augmenter la responsabilité individuelle et de réduire le fardeau collectif. La hausse des droits de scolarité est donc effectivement symptomatique d’une “révolution culturelle” qu’on étiquette volontiers de « néolibéralisme ».
Cela dit, malgré ce que certains semblent croire, qualifier un programme politique de néolibéral ne suffit pas à clore le débat. Contrairement aux pays scandinaves qu’on ne cesse de prendre en exemple, la situation financière du Québec est insoutenable à long terme. Notre bureaucratie est pesante. Nous sommes fortement taxés et imposés. Notre population vieillit. La dette et les régimes de retraite (entre autres) exercent une pression financière qui limite les choix publics et appelle des réformes. S’il est légitime de s’opposer à une mesure ou à une autre (comme la hausse des droits de scolarité), il semble qu’on puisse difficilement — dans les circonstances qui sont les nôtres — plaider à la fois pour le « bien commun » à long terme et exiger le maintien du statu quo ou l’expansion d’un modèle à bout de souffle. Je cherche encore les propositions de l’Alliance sociale qui auront réalistement pour effet d’alléger la charge de l’État et de favoriser la croissance et le dynamisme de notre économie.
Le mouvement étudiant (et maintenant celui des casseroles) a raison de critiquer le gouvernement Charest pour sa gestion de la crise actuelle et de plusieurs autres dossiers, incluant la récente loi 78. Le gouvernement a mis des mois à comprendre l’ampleur et l’intensité de la contestation en cours et il a souvent réagi de manière maladroite ou contre-productive. Les étudiants ont eu raison d’investir les médias sociaux et d’organiser des manifs originales pour diffuser leur message. Ils ont raison, à bien des égards, de crier que notre système démocratique est dépassé et qu’il a besoin de réformes — notamment le mode de scrutin, la discipline de parti, la transparence et le financement politique.
Mais dans le bouleversement actuel, le danger est de jeter le bébé avec l’eau du bain. Critiquer une politique sur toutes les tribunes et par tous les moyens pacifiques, c’est exercer ses droits démocratiques. Vandaliser, diffamer, intimider, refuser les lois et défier les tribunaux, par contre, c’est s’attaquer aux fondements mêmes d’un système qui — bien qu’imparfait — civilise les sociétés en les protégeant de la tyrannie des masses, de la loi de la jungle et des jusqu’auboutistes de tout acabit. Dénoncer un gouvernement est une chose; refuser l’autorité de l’État en est une autre. Il arrive que ce soit nécessaire, quand on se bat contre une dictature ou pour des libertés fondamentales. Or, faut-il le rappeler, le Québec n’est pas la Syrie, et une hausse tarifaire n’a rien d’une attaque contre des libertés fondamentales.
---
NDLR