
Environnement: Richard Desjardins
L’empêcheur de bûcher en rond
Le crime qui se commet actuellement contre la forêt est si grave que le chanteur préfère s’éloigner de la musique pour le moment
PAR GEORGES-HÉBERT GERMAIN
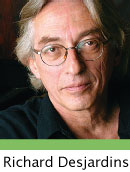 |
|---|
Richard desjardins ne décolère pas souvent, et jamais bien longtemps. Sauf quand il parle de ceux qu’il aime ou a aimés. De ses parents qu’il a perdus: «Le piano, je tiens ça de ma mère; le chant, c’est mon père.» De ses vieux chums du groupe Abbittibbi. Ou de sa première blonde avec qui, à 20 ans, il a voyagé pendant un an, sac au dos, jusqu’à la Terre de Feu: «Juste pour voir le monde qui, dans ce temps-là, était encore beau et propre…»
Mais voici la colère revenue, une belle colère de fond, pure et dure, pas aveugle, mais au contraire bien lucide, solidement documentée et parfaitement maîtrisée, braquée en permanence sur ceux qui – «par cupidité, sûrement pas par ignorance, parce que ce qui se passe là-haut, ça ne peut pas être ignoré» – sont en train de détruire la forêt boréale.
Desjardins (Richard), Rouyn-Noranda, 1948, est entré dans le Larousse, édition 2006, qui le présente comme un «chanteur et auteur-compositeur canadien». En fait, la musique et la chanson prennent de moins en moins de place dans sa vie. Il serait plus exact désormais de le définir comme un activiste écolo à temps plein, plus cinéaste que musicien. Son projet de l’heure: tourner un film sur le peuple algonquin de Maniwaki, dépossédé de ses terres au profit de ceux qui dévastent la forêt boréale.
«De la musique, j’en écoute encore dans mon char, dit-il. A la maison, jamais. Et, en ce moment, j’écris pas de chanson. Pour faire une toune, il faut un bon climat.» Or le climat qui, de nos jours, sévit sur nos vies ne lui donne pas tellement le goût de chanter. Il y a plus urgent, plus nécessaire.
S’il lit toujours beaucoup, ce ne sont plus des romans et de la poésie, comme autrefois, mais des rapports, des procès-verbaux, des documents sur la forêt, la biologie, l’industrie du bois, la business forestière… Il lit pour apprendre, pour affûter ce discours d’assaut qu’il ponctue d’éclats de rire grinçants comme une débroussailleuse. Pas de quartier, pas de pitié pour les compagnies forestières, ces «rapaces», ni pour les fonctionnaires, ces «ignares inconscients». Il se dit en état de «légitime défense» et affirme que, dans le combat qu’il mène, tous les coups lui sont permis.
Aux hommes sur le terrain, aux ingénieurs forestiers, il reproche d’avoir fermé les yeux et refusé de voir et de faire savoir que la forêt était mal en point. «Ils ont cherché uniquement à en sortir le plus gros volume de bois possible. Depuis toujours, ils ont vécu et travaillé dans le déni le plus total et fait preuve d’une lâcheté sans nom. Personne ne s’est levé pour que cesse le massacre. Et, pourtant, ils avaient sous les yeux toutes les preuves qu’un crime était commis.»
Desjardins, lui, a tout vu. «Pas besoin d’être médecin pour voir que quelqu’un est malade», dit-il, paraphrasant Bob Dylan. Et il est passé à l’action, investissant dans sa cause, sa notoriété, son talent, son temps, ses énergies. Avec son complice Robert Monderie, il a réalisé en 1999 L’erreur boréale, véritable détonateur qui a provoqué et provoque encore d’importants remous au sein de l’industrie forestière. Puis il a fondé l’ABAT (Action Boréale Abitibi-Témiscamingue), qui compte aujourd’hui plus de 3000 membres à travers le Québec. L’ABAT enquête, talonne, questionne, ne fait de cadeau à personne, n’en démord jamais… Son action se limite à la forêt boréale – «parce que c’est déjà pas mal vaste et qu’on connaît le terrain. La forêt de feuillus du sud est mal en point, elle aussi, mais c’est un tout autre contexte, une autre guerre à mener.»
On a reproché à Desjardins ses excès de langage et une certaine démagogie, ainsi que de vouloir faire de la forêt boréale un bibelot intouchable réservé à quelques happy few. «C’est exactement le contraire qu’on veut faire, dit-il. La forêt devrait appartenir à tout le monde, pas à quelques compagnies qui ne pensent qu’à l’exploiter. Bien aménagée, elle devrait nous rapporter collectivement des fortunes et nous aider à vivre mieux, à construire des hôpitaux, des routes, à créer de la richesse et du bien-être… Or, l’année passée, loin de nous enrichir, elle nous a coûté 50 millions. Pendant ce temps-là, Loto-Québec, Hydro-Québec et la SAQ rapportaient plus de trois milliards dans les coffres de l’Etat.»
Il se désole aussi qu’on n’ait pas été capables de créer ici une industrie originale et lucrative de transformation du bois, comme les Suédois avec IKEA, par exemple. «On fait surtout du bas de gamme, des pâtes, du papier journal, des 2x4, des palettes…»
Distribuant les reproches à tous les intervenants, Desjardins s’est fait d’irréductibles ennemis. «J’ai eu droit à des lettres anonymes et à des chars de bêtises livrés par téléphone ou sur Internet, des affaires de lâches et de peureux.» Il a également reçu de nombreux appuis.
Le très sérieux rapport Coulombe, publié en décembre 2004, lui a donné raison sur presque toute la ligne. Dès lors, la grande majorité de ses opposants se sont tus. Aujourd’hui, beaucoup à cause de lui, le monde forestier québécois est en état de choc, et le gouvernement québécois s’est enfin résolu à encourager le développement d’industries de transformation du bois… Desjardins n’est pas pour autant satisfait.
On a réduit de 20 pour 100 le volume de bois que le gouvernement autorise les compagnies à prélever sur les territoires qu’il leur a concédés. «Ça ne veut pratiquement rien dire, affirme-t-il, puisqu’on connaît très mal la possibilité de la forêt boréale. C’est le ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui, en principe, se charge de l’évaluer. Mais le rapport Coulombe a révélé que la marge d’erreur dans leur calcul excédait régulièrement les 35 pour 100.»
Selon lui, il faudrait tout arrêter pendant plusieurs années, tout de suite, cesser de dilapider le capital forestier et repenser notre affaire. Or il y a au Québec quelque 37000 emplois liés à la forêt et sur lesquels se fonde l’argument majeur qu’on oppose à Richard Desjardins. Les compagnies forestières, jouant «les terroristes», ont clamé bien haut que toute interruption de leurs activités entraînerait des milliers de pertes d’emploi.
«En fait, dit Desjardins, avec leurs grosses machines, elles ont supprimé déjà plus d’emplois qu’il n’en reste. Et, si on les laisse aller, dans quelques années il n’y aura plus d’emplois du tout, parce qu’il n’y aura plus de bois.»
Ce qui le conforte dans son combat, c’est qu’on sait aujourd’hui que la catastrophe annoncée, lors de la sortie du rapport Coulombe, ne s’est pas réalisée. Le Conseil de l’industrie forestière avait alors prévu de 10000 à 16000 pertes d’emplois. Or, en novembre dernier, six mois après l’entrée en vigueur de la réduction de coupes, on n’en comptait pas 700. De plus, le gouvernement du Québec annonçait le même mois qu’il allait injecter 450 millions pour atténuer l’impact de la baisse des coupes, stimuler la recherche sur les techniques sylvicoles d’aménagement, négocier ce virage du côté de la transformation que réclame Desjardins, et chercher puis adopter de nouvelles méthodes d’exploitation.
Il y a déjà quelques modèles fort intéressants, même aux yeux sévères et exigeants de Desjardins. La Forêt de l’Aigle, près de Maniwaki, par exemple: on y fait de la chasse et de la pêche, de l’écotourisme, et on en tire d’importantes quantités de bois de grande qualité. Depuis une dizaine d’années, une société de gestion formée de représentants du milieu (dont les Algonquins, justement) a considérablement valorisé ce territoire de 140 km2 et fait la preuve qu’il y a moyen d’exploiter une forêt sans l’épuiser… «et surtout sans la présence destructrice de la grande industrie».
Richard Desjardins, qui ne pèche jamais par optimisme quand il est question de forêt, ne croit pas que les com pagnies voudront imiter ce modèle, ni même qu’elles en soient capables.
«Des paquebots géants, ça met un temps fou à virer de bord. Or il faudrait changer dès maintenant les habitudes, les mentalités, les méthodes. Et, pour commencer, la machinerie. Le sol de la forêt boréale est fragile. Les garettes et les abatteuses l’ont déjà considérablement abîmé.»
Il y a pire en effet que la coupe; il y a la destruction du sol de la forêt boréale. Ainsi, ramasser le bois brûlé après un incendie, comme on l’a laissé faire sur l’île René-Levasseur (au centre du réservoir Manicouagan), c’est, selon lui, un crime contre la forêt. «Ce bois brûlé, c’était sa nourriture. Sans cet engrais, elle va crever.» Et il faudra repartir à zéro.
Le reboisement? Il n’y croit pas. «Personne ne sait ce que ça va donner. Il n’y a pas encore au Québec de forêts plantées par l’homme qui soient parvenues à maturité. Mais on se doute un peu que ce sera assez monstrueux, parce qu’en reboisant avec une seule espèce on détruit la biodiversité, ce qui est le pire des maux.»
Les Scandinaves, qui font de la monoculture forestière depuis plus d’un siècle, constatent aujourd’hui les dégâts. Leurs forêts plantées sont vides d’animaux et ont perdu beaucoup d’espèces végétales. «Pour restaurer leurs forêts, ils doivent maintenant importer des lichens, des mousses, des insectes, des champignons, des arbustes, des oiseaux… Or il y a encore ici, au Québec, des gens pour dire qu’il faut les imiter, qui parlent avec admiration du modèle suédois. Ça fait bien sûr l’affaire des compagnies parce qu’une forêt d’épinettes plantées en quinconce, si ça se rend à maturité, c’est infiniment moins cher à bûcher.»
C’est un fait, constaté avec stupeur par les membres de la commission Coulombe, que le gouvernement québécois ne semble pas savoir quel modèle adopter et qu’il change sans cesse de méthode et de plan. Il y a quelques années, les éclaircies précommerciales étaient la mode. Il s’agissait de pratiquer une sorte d’eugénisme: on favorisait les plus beaux spécimens, en détruisant leurs chétifs congénères.
«On a obtenu de plus gros arbres, avoue Desjardins, mais il y en a moins. Au bout du compte, on a fait plus de dégâts et on n’a pas récolté plus de bois.»
La bonne nouvelle, selon lui, c’est que les compagnies sont aujourd’hui en mauvaise posture financière. Il semble en effet que les compagnies forestières se retrouvent maintenant le bec dans l’eau, pour avoir surexploité la forêt sans penser à en assurer la régénérescence.
Autrefois, pour emprunter, il leur suffisait de dire à la banque que le gouvernement leur avait concédé quelques centaines de milliers d’hectares de forêt. Or, aujourd’hui, la banque veut voir de quoi a l’air la forêt et en connaître la rentabilité financière. Elle ne prête plus si facilement parce qu’elle sait, alertée par Desjardins, par L’erreur boréale et l’ABAT, que la forêt n’est plus ce qu’elle était.
«Si tout se passe bien, les temps vont bientôt être durs pour les grandes compagnies», prophétise Richard Desjardins avec un sourire sardonique. Prudent, il ajoute:
«Mais faut surtout pas baisser les bras tout de suite.»